La "Vendée Militaire" par rapport :
aux anciennes provinces
aux nouveaux départements
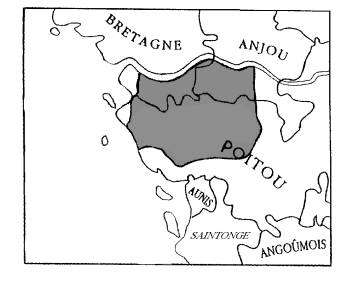
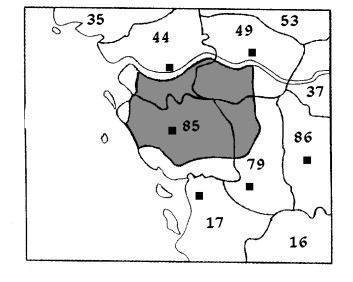
"On a touché au château et les Vendéens ont vu avec indignation les brimades contre les maîtres. On a touché à l'Eglise et ç'a été de la colère. Enfin, on a touché au pignon de la ferme, goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors les hommes exaspérés laissent un jour leur champ à moitié labouré, retroussent leurs manches et, en gens bien décidés à mettre de l'ordre dans la maison, disent simplement: Il faut en finir " |
||
Jean Yole poète vendéen |
||
Le 14 juillet 1989, la France fetait avec faste, devant les représentants des autres nations industrialisées, le bicentenaire de sa Révolution.
Le 11 mars 1993, qui, à l'exception de quelques "nostalgiques", se souvint que 200 ans auparavant, dans le Pays de Retz, dans les Mauges Angevines, dans le Bocage Poitevin, les jeunes gens des campagnes, refusant le tirage au sort de la conscription, sonnaient le tocsin au clocher de leurs paroisses. C'est ce jour là que commença ce que le "Larousse" appelle les "Guerres de Vendée", que Barrère à la barre de la Convention et dans ses rapports au Comité de Salut Public désigne comme "I'inexplicable Vendée", le "cancer de la Vendée" ou encore ''le charbon politique qui dévore le coeur de la République Française", et que ceux qui y survécurent ont simplement appelé "la Grand Guerre " .
Mais la Vendée c'est quoi ?
Une petite rivière de 70 km de long, affluent de la rive droite de la Sèvre Niortaise, qui par une de ces bizarrerie dont l'histoire est friande, donna son nom à un département. Voici comment.
Lors de la création des nouvelles subdivisions administratives, en 1790, le Poitou, cette province du sud de la Loire qui s'étend de la vallée de la Gartempe à la mer donna naissance à trois départements: la Vienne avec pour chef lieu Poitiers, les Deux Sèvres dont la préfecture fut, après bien des péripéties, installée à Niort, enfin un département avec pour chef lieu Fontenay le Comte et auquel il était prévu de donner un nom rappelant la principale rivière qui le traverse: le Lay, affiuent de la rive droite de la Sèvre Niortaise, réunion du Grand et du Petit Lay. D'où la proposition "Deux Lays" comme il y avait "Deux Sèvres". Mais ... deux des députés de cette zone géographique à l'Assemblée Constituante n'avaient rien à voir avec la beauté grecque ! On décida donc, pour ménager leur susceptibilité, de donner à cette partie du territoire, le nom de la rivière qui traversait son chef lieu. Le département de la Vendée était né. La Roche sur Yon n'en deviendra la préfecture qu'en 1804 sous le nom de "Napoléon Vendée" et l'Yon, autre petite rivière ne donnera pas son nom au département.
Ainsi de "Bas Poitevins", mes ancêtres du bocage, tisserands et artisans installés à La Gaubretière depuis plus d'un siècle devinrent-ils "Vendéens".
"Vendéen ! Ah, un chouan ! ", voila ce que j'entends souvent, heureusement sans me vexer. Et bien "NON", cent fois, mille fois "NON", un Vendéen n'est pas un Chouan ! Vous n'auriez jamais l'idée de dire' à un habitant de Strasbourg: "Alsacien ! Ah, un allemand !" Et bien de la méme façon que le Rhin sépare Alsaciens et Allemands, la Loire sépare Vendée et chouannerie. Si les deux modes de révolte ont existé, ils n'ont jamais rien eu en commun, ni dans les circonstances de leur naissance, ni dans leur structure, ni dans leur façon de combattre, ni dans leur disparition.
La chouannerie, en Bretagne, en Normandie, dans le. Maine et le Perche est constituée de petites bandes permanentes ayant chacune un chef: noble, prisonnier évadé, faux saulnier, marginal ... Jamais ces bandes ne se rassemblent ni n'organisent d'opérations communes et la population des villages est étrangère aux opérations.
A l'opposé, en Vendée, c'est le pays tout entier qui, à l'appel du tocsin se soulève. Quelques jours avant le rassemblement, le Grand Conseil de Chatillon a décidé du jour et du lieu, les messagers ont porté l'information dans toutes les paroisses. Au jour prévu, les cloches sonnent, les paysans-soldats se rassemblent sur la place du village. Ils ont pris leurs armes et de la nourriture pour la durée prévue de l'opération (jamais plus de 3 ou 4 jours). Le capitaine de la paroisse, élu par ses concitoyens emmène la petite troupe vers le lieu de rendez-vous où il se met sous les ordres de son général, membre du Grand Conseil qui dirige la manoeuvre de cette troupe courageuse mais souvent indisciplinée et qui une fois la bataille livrée, la ville prise ou l'armée républicaine battue abandonne ses chefs et rentre chez elle pour "changer de chemise". Un soldat raconte dans ses souvenirs avoir quitté ainsi 45 fois son foyer pour l'armée.
Les 660 paroisses qui se soulèvent en mars 1793 ne forment ni une unité géographique, ni un unité économique. Sous le nom générique de "Vendée" se retrouvent une bonne partie du nouveau département, mais pas sa zone sud (plaine de Lucon et de Fontenay et Marais Poitevin), ni la bande côtière (régions de l'embouchure de la Vie et Pays de Mont), ni les îles (Noirmoutier, Yeu). En revanche, font aussi partie du "pays insurgé": le sud de la "Loire Inférieure" devenue "Atlantique" (à l'exception de la bande côtière), le sud-ouest de la "Mayenne et Loire" devenu le "Maine et Loire" et le nord-est des "Deux Sèvres".
La "Vendée Militaire" par rapport : |
|
aux anciennes provinces |
aux nouveaux départements |
|
|
De mars à octobre 1793, sur ce vaste territoire de 10.000 km2 trois armées se feront et se déferont face aux forces républicaines.
A l'est: la "Grande Armée Catholique et Royale d'Anjou et du Haut Poitou" constituée des division de Bressuire (Lescure), des Mauges (Cathelineau), de la Loire (Bonchamps), de Maulévrier (Stofilet), de Cholet (d'Elbée) et d'Argenton (Laugrenière). Forte de 40.000 hommes, c'est la masse de manoeuvre principale de l'insurrection.
A l'ouest: I"'Armée de Retz et du Bas Poitou" avec les divisions des Sables (Joly), du Loroux (Lyrot) et de Machecoul (Charette) auxquelles se joignent des "indépendants": La Cathelinière, Couëtus, La Robrie, Guérin. Ses 15.000 hommes isolaient La Rochelle de Nantes et gardaient le littoral.
Entre les deux: l'"Armée Catholique et Royale du Centre" avec les divisions de Montaigu (Royrand), de Mortagne (Sapinaud de la Verrie) et de la Chataigneraie (Baudry d'Asson). Avec 10.000 hommes elle tenait en respect les républicains stationnés à Niort. Mes ancetres combattaient sous les ordres de M. de Sapinaud.
Les causes de la "révolte des départements de l'Ouest" ne peuvent, comme on a souvent voulu le faire accroire, se résumer à un rejet du régime politique de l'époque ou à une volonté purement religieuse. Pour ma part je considère que Jean Yole cité en introduction est le plus près de la réalité. Trois faits, insuffisants par eux-mêmes, se conjuguent en ce printemps 1793: la Constitution Civile du Clergé votée en juillet 1790 et dont l'application heurte la structure sévulaire des paroisses et persécute les prêtres, souvent enfants du pays; le jugement, la condamnation et l'exécution du Roi qui font disparaître les repères de la société civile; enfin la levée des 300.000 hommes dont les modalités dans la région sont pour le moins explosives: les Gardes Nationaux, en majorité des bourgeois des villes, acquéreurs des biens nationaux, et donc nouveaux propriétaires des terres, sont exemptés de tirage ! Il existe de nombreux ouvrages sur le sujet, j'y renvoie le lecteur intéressé.
Du 3 mars 1793, jour où les gars de Saint Florent le Vieil manifestent aux cris de: "On ne partira pas ! Aux habits bleus de partir !" au 29 mars 1796, jour de l'exécution de François Athanase Charette de la Contrie sur la place Viarmes à Nantes, I'histoire de la révolte vendéenne peut être divisée en trois grandes périodes:
Mars 1793 - décembre 1793 : les opérations militaires, avec tout ce que cela sous-entend en cette fin du XVIIIème siècle de barbarie, d'incendie, de massacres . . . etc.
Janvier 1794 - octobre 1794 : ce que d'aucuns ont appelé à juste titre "Le génocide" et que pour ma part je préfère dénommer " Le massacre des innocents ",
Octobre 1794 - mars 1796: l'impossible pacification.
C'est à midi le 10 mars 1793 qu'un paysan appelé Raynard arrive tout essoufflé chez Jacques Forestier, notaire royal à La Gaubretière. Il lui annonce que de tous les hameaux alentour des hommes en armes convergent vers la petite ville. Le notaire, confident et ami de tous sait que depuis quelques temps, la tension monte dans ce coin du bocage vendéen. Il n'est pas surpris par les événements ! Rapidement il donne l'ordre de sonner le tocsin au clocher de l'église.
Le sacristain s'appelle François Augereau, né à La Boissière du Doré (à quelques Icilomètres) en 1750, il a épousé en 1773 une certaine Jeanne Goineau, fille du sacristain du moment et à la mort de son beau-père il lui a succédé dans sa charge. De leur mariage naîtront au moins six enfants dont la quatrième, Aimée Perrine, née en 1781, épouse en l'an X (1802) un tisserand du village: René Rambaud mon ancêtre direct à la cinquieme generation.
Ces coups égrenés au clocher de la paroisse marquent le début de la première période des événements de Vendée. François Augereau sonnera beaucoup d'autres tocsins, jusqu'à ce jour de février 1794 où, trouvé par les "Bleus" près de La Gaubretière, il sera fusillé sans autre forme de procès. Il avait accompagné un prêtre réfractaire portant à un mourant les derniers sacrements et avait caché sur lui des hosties consacrces .
La déclaration de son décès sur le témoignage de sa femme attesté par Pierre Grimaud, marchand et Pierre Bonnard, tisserand figure sur un registre clandestin conservé aux archives départementales de la Vendée, précieux témoignage de cette époque troublée.
 |
 |
La premiére période des événements qui nous intéressent peut se subdiviser elle même en trois époques :
Mars 1793- juin 1793: la Vendée victorieuse
Juin l793-octobre l793 la Vendée parfois battue, jamais abattue
Octobre 1793 - décembre 1793 : la folle "Virée de Galerne
Ceux que les détails de ces évènements intéressent trouveront dans les nombreux ouvrages les relatant de quoi satisfaire leur curiosité. Je me contenterai pour ma part d'un survol rapide
Première période: "la Vendée victorieuse".
Prendre un vieux fusil, une houe, une faux ou un simple gourdin et partir de chez soi avec les amis d'à côté c'est facile, mais ce n'est pas faire la guerre. Alors les paysans soldats vont chercher leurs " Messieurs" pour les mettre à leur tête, et dans certains cas cela n'a pas été facile: Charette s'est caché sous son lit ! Sapinaud de la Rairie a temporisé 4 jours, a été menacé plusieurs fois de mort et adossé à un mur ! même Henri de La Rochejacquelein a essayé de parlementer ! Les autorités locales de la République ne peuvent guère opposer à la fougue des mécontents que quelques troupes médiocres formées de Gardes Nationales et de soldats de la première réquisition commandés par des "ci- devant", officiers de l'Ancien Régime adeptes des idées nouvelles. Méconnaissant totalement le type de combat auquel ils doivent faire face (nous l'appellerions aujourd'hui "guérilla"), étrangers au pays et incapables de se mouvoir dans le dédale "labyrinthique" du bocage, les " Bleus" sont des proies faciles pour les paysans devenus soldats habitués à passer d'un champ à l'autre sans ouvrir les barrières et courant leurs sabots à la main. Et pour ajouter à la confusion l'abbé René Charles Lusson, vicaire de Saint Georges de Montaigu a écrit des paroles chrétiennes (et poitevines) sur la musique de la Marseillaise. Les insurgés, braconniers et donc fins tireurs, font de véritables ''cartons" . Petit à petit ils conquièrent les campagnes et les bourgs puis les villes, mais ils ne se maintiennent pas dans leurs conquêtes et des généraux Républicains audacieux, tel Westermann, réalisent des raids sanguinaires.
Deuxième période: La Vendée parfois battue mais jamais abattue.
Nantes ! la grande ville, siège de ce que les paysans croient etre le pouvoir ! Peut-être suffirait-il de la conquérir pour que le cauchemar cesse ? C'est ce que le Grand Conseil a décidé, c'est ce qui va etre tenté le 29 juin 1793, c'est la seule opération concertée à laquelle toutes les "armées" et toutes les "bandes" participeront. C'est aussi le grand tournant: alors que l'armée d'Anjou avec à sa tête Jacques Cathelineau arrive sur la place Viarmes, un ouvrier cordonnier républicain repère, à sa tenue, le généralissime, épaule son fusil, vise et tire. Le Saint de l'Anjou s'écroule, blessé. Très vite la nouvelle se répand, I'incrédulité puis l'abattement gagnent de proche en proche, " La Grande Armée Catholique et Royale" démoralisée, bat précipitamment en retraite. Désormais rien ne sera plus comme avant, d'autant que les opérations menées contre Fontenay le Comte et Luçon échouent et que la République ne sachant que faire de ses troupes battues à Mayence et à Valenciennes et libérées avec les "Honneurs de la guerre" les dirige vers la Vendée. Les paysans soldats ont désormais en face d'eux des soldats "professionnels" qui dans un premier temps les cantonneront dans leur territoire puis petit à petit accentueront leur pression jusqu'à la décisive bataille de Cholet. Les vendéens remporteront encore des succès comme à Torfou où ils battent ce qu'ils croient étre l'Armée de Mayence (qu'ils surnommeront ensuite "Armée de Faience") et n'est en fait que son avant garde !
Troisième période : La folle " Virée de Galerne. (Le vent de Gale7ne c'est le vent froid qui vient l'hiver du nord-ouest, de l'autre côté de la Loire)
Le 17 octobre 1793, au nord de Cholet, se retrouvent face à face les 35.000 combattants de la Grande Armée et de l'Armée du Centre et les 32.000 soldats de la République. Le choc" commence à 13 heures. Le combat est longtemps indécis. A la nuit tombante, par un de ces retournements dont les vendéens sont coutumiers, la victoire qui était à leur portée leur échappe et un cri retentit: "A la Loire ! A la Loire !". C'est la débandade vers le nord. A Saint Florent le Vieil, ce sont 80.000 personnes (chiffre estimé et très approximatif) dont la moitié de non combattant qui en moins d'une nuit et une journée vont traverser le fleuve sur des embarcations de fortune. Pendant ce temps, Marie Joseph Louis Gigost d'Elbée blessé est transporté en charette à boeufs à La Gaubretière puis de là vers Noirmoutier. Sans en avoir la moindre preuve, je suppose que les hommes de ma parenté et sans doute mon ancêtre direct l'ont escorté durant ce périple.
Partis le 19 octobre de Varades sur la rive droite de la Loire, les vendéens arrivent le 14 novembre sous les murs de Granville. Ne pouvant s'emparer de la ville, découragés, malades, les survivants tenteront en vain de retourner dans leur pays.
Le 23 décembre 1793, pour les 10.000 à 12.000 rescapés, la folle aventure se termine dans les bois et les marais de Savenay.
|
"Bientôt il n'y aura plus de trace de l'armée brigantine et l'on pourra dire que la guerre de Vendée est finie. On m'avait confié la garde de la Vilaine, nul ne l'a passée, nul ne la passera. Je ne veux pas de prisonniers, ils mettraient la peste dans notre armée. Que les amis de la royauté aillent dans l'autre monde rejoindre les tyrans; ils les aiment, qu'ils restent avec eux. " Auguste Joseph Tribout, Général de division.
"Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre, avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds d es chevaux, massacrés les femmes qui, au moins pour celles- là, n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonniers à me reprocher. J'ai tout exterminé.. . Les routes sont semées de cadavres. Il y en a tant que sur plusieurs endroits ils font pyramide. " François Joseph Westermann, Général de brigade .